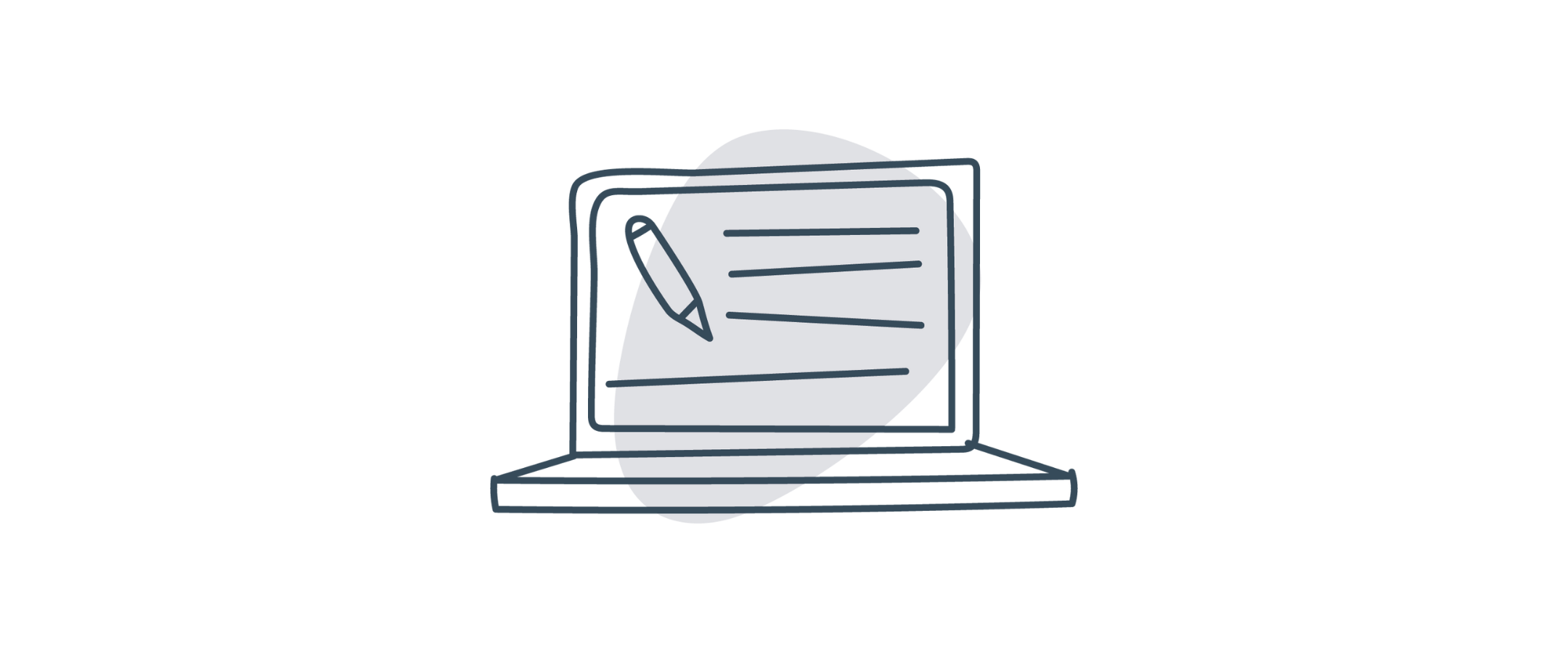
Vécus d’allaitement : comprendre l’apprentissage de l’allaitement avec l’ergothérapie durant la matrescence
Par Audrey Clavet, ergothérapeute en périnatalité à la clinique Matrescence
Devenir parent transforme chaque aspect de la vie. Les routines changent, l’identité se transforme et de nouvelles responsabilités s’imposent. Parmi ces transformations, l’allaitement occupe une place centrale pour de nombreuses familles qui choisissent ce mode d’alimentation pour leur enfant. Pourtant, malgré son apparence « naturelle », allaiter est une expérience qui se révèle bien plus complexe qu’il n’y paraît, qui s’ajoute à une étape développementale aux multiples facettes : la matrescence.
Le mot matrescence, introduit dans les années 1970 par l’anthropologue Dana Raphael et popularisé plus récemment par la psychiatre Alexandra Sacks, désigne le processus développemental que vit une personne lorsqu’elle devient mère ou le parent principal donneur de soins. Tout comme l’adolescence, la matrescence est une période de bouleversements identitaires, physiologiques, psychologiques, cognitifs, émotionnels, spirituels, sociaux et occupationnels. Les changements occupationnels peuvent être décrits comme des changements dans nos activités de la vie de tous les jours.
L’allaitement est l’une des nombreuses activités – ou occupations – qui peuvent être ajoutées dans le répertoire d’occupations d’un nouveau parent dans le cadre de cette transition . Cette occupation devient non seulement un moyen de nourrir son enfant, mais les recherches suggèrent – tout comme le suggère aussi le vécu des nombreux parents que j’ai accompagné à travers les années – que l’allaitement est aussi un marqueur identitaire puissant. Pour de nombreux parents, leur sentiment de compétence d’allaitement influence directement la perception qu’ils ont de leur compétence parentale. Or, cette perception n’émerge pas dans le vide : elle est fortement façonnée par la culture, les discours sociaux et les attentes qui pèsent sur les mères. Entre les nombreuses injonctions qui entourant la maternité et la matrescence (« allaite exclusivement », « mais pas trop longtemps », « sois disponible la nuit », « retrouve rapidement ton corps et ton énergie »), les parents se retrouvent souvent pris dans une véritable tempête de pressions.
L’allaitement comme occupation : la vision de l’ergothérapie
En ergothérapie et dans les sciences de l’occupation, le terme « occupation » désigne toutes les activités qu’une personne peut, veut ou doit faire. Elles sont souvent liées à des rôles qui sont importants pour les personnes. L’allaitement est une occupation partagée entre les parents et le bébé qui demande du temps, de l’énergie et de l’organisation. Son apprentissage peut s’accompagner de différents défis et surtout, surtout, d’un vécu émotif auquel on ne pensait peut-être pas être exposé. Colère, sentiment d’abandon ou d’incompétence, tristesse, incompréhension peuvent côtoyer le bonheur, le sentiment de dépassement quand on relève un défi, et même l’émerveillement devant notre corps qui peut nourrir un être humain Toutefois, au-delà des bienfaits de l’allaitement pour bébé, il est important de réfléchir au soutien disponible autour du parent qui allaite. En effet, est ce que cette personne qui allaite a accès à du soutien pour allaiter? Quel type de soutien? Est-ce que son environnement et les conditions favorisent un allaitement serein? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont les motivations derrière l’allaitement?
Après tout, l’allaitement n’est pas qu’un acte biologique, mais une occupation profondément influencée par l’environnement social, culturel, politique et institutionnel. En ergothérapie, il est possible d’accompagner tous les allaitements – qu’ils soient exclusifs, mixtes, induits ou encore interrompus par choix. L’ergothérapeute considère toutes personnes impliquées dans l’occupation d’allaitement, notamment le parent allaitant et son bébé, mais aussi l’autre parent qui participe dans l’orchestration des routines autour de l’allaitement. La thérapeute observe donc l’ensemble des autres occupations qui sont reliées à l’allaitement (sommeil, autres moyens d’alimentation, routines, etc.), ainsi que les facteurs propres à chaque individus, que ce soit la sphère émotionnelle du parent, ses attentes, ses valeurs, ses douleurs, ainsi que les éléments appartenant au bébé, comme la prise au sein, la succion et les tensions musculaires, pour ne nommer que ces exemples. L’ergothérapeute prend donc en considération plusieurs éléments, tant physique que psychologique et environnemental, pour soutenir l’atteinte des objectifs d’allaitement de la dyade. Bien entendu, l’ergothérapeute travaille en collaboration avec plusieurs autres professions de la santé vers l’atteinte des objectifs du parent, mais son expertise unique, au croisement de toutes les dimensions de la personne, en fait un acteur indispensable dans l’écosystème de soutien de l’allaitement.
Allaiter : un apprentissage, pas un instinct immédiat
L’allaitement est souvent perçu comme un réflexe inné, une pratique « naturelle » qui devrait s’enclencher spontanément. En réalité, chaque dyade parent-bébé est unique. Même un parent expérimenté doit réapprendre avec chaque enfant, puisque le tempérament, la succion et les besoins diffèrent. Les difficultés (gerçures, mastites, fatigue, inconfort) ne sont pas des échecs, mais des réalités fréquentes. Reconnaître cet aspect d’apprentissage permet de réduire la culpabilité et d’ouvrir la voie à un accompagnement bienveillant.
Or, allaiter est naturel comme apprendre à marcher, et non comme respirer. Cela signifie que, bien qu’il s’agisse d’une fonction biologique prévue par la nature, il s’agit aussi d’un apprentissage, autant pour le parent qui allaite que pour le bébé. Ceci demande du temps, du soutien et parfois des ajustements. – Audrey, ergothérapeute
Les multiples dimensions de l’allaitement
Réduire l’allaitement à une question de grammes pris par le bébé ou de minutes passées au sein est une approche réductrice malheureusement souvent prédominante. L’allaitement c’est aussi :
Physique et physiologique : positions d’allaitement, douleurs, fatigue, récupération postnatale, hormones.
Émotionnelle et psychologique : sentiment de compétence parentale, anxiété, ambivalence, biais cognitifs ou attentes souvent élevées quant au rôle de la “bonne mère”, deuils vécus à travers l’expérience d’allaitement.
Sociale : soutien du/ de la partenaire, de la famille, du réseau communautaire.
Environnementale : conciliation avec le travail, aménagement de l’espace de vie, avoir accès à des aides techniques pour faciliter notre allaitement.
Culturelle : normes sociales, acceptabilité de l’allaitement en public, injonctions sur la durée.
Informationnelle : avoir accès à de l’information de qualité au moment approprié.
Occupationnelle : plusieurs autres occupations sont impactés ou influencés par l’ajout de l’allaitement, et influencent aussi l’apprentissage de l’allaitement. On ne peut donc pas considérer l’allaitement seule dans son silo.
Et bien plus !
L’expérience de l’allaitement est complexe et il est crucial de prendre en compte l’ensemble de ses dimensions pour accompagner chaque parent dans son cheminement, quelle que soit sa décision concernant la méthode d’alimentation (allaitement au sein, tire-allaitement, allaitement mixte ou absence d’allaitement). De plus, certaines occupations parentales apparemment simples — donner un bain, sortir seule avec bébé, gérer les nuits — peuvent devenir des défis et générer un vécu émotif complexe. L’ergothérapeute peut aider à identifier ces sources de stress et à renforcer les compétences parentales pour retrouver un sentiment de sécurité et de maîtrise.
L’expérience d’allaitement compte aussi!
La recherche démontre que l’expérience de l’allaitement influence directement la perception de compétence parentale. En effet, quand l’allaitement est perçu comme difficile, le parent peut se sentir « incompétent», ce qui peut alimenter la tristesse, l’anxiété et la culpabilité. À l’inverse, un parent qui se sent outillé et bien accompagné, et qui a l’impression d’être en mesure d’apprendre cette occupation et de faire face aux défis qui se présentent favorise l’estime de soi parentale. Un accompagnement bienveillant visant à soutenir le développement du sentiment de compétence parental et la confiance favorise l’atteinte des objectifs d’allaitement du parent. Il est important de rappeler que l’allaitement n’est pas indispensable au développement de l’attachement ou de la santé du bébé. Ce qui importe, c’est que le parent se sente bien dans ses occupations, qu’il soit disponible émotionnellement et qu’il vive une expérience alignée avec ses valeurs.
En effet, bien que l’allaitement soit excellent pour bébé et qu’il soit recommandé par les instances nationales et internationales, il est essentiel que le choix d’allaiter ou non soit laissé aux parents puisque c’est la mère ou la personne allaitante qui sera impliquée à tous les instants. Ce sont ses occupations qui seront bouleversées par l’arrivée du bébé, etles réalités individuelles de chaque famille sont uniques – contexte familial, retour au travail, santé physique et mentale,etc. Ces réalités nécessitent des approches et des interventions en cohérences avec les valeurs de chaque famille.
C’est dans cette approche que l’ergothérapie prend tout son sens : en aidant les parents à identifier leurs priorités, à organiser leur quotidien et à transformer un défi en solution concrète, afin de contribuer à transformer l’expérience de l’allaitement en une occupation positive.
Soutenir le choix des parents
L’allaitement ne peut pas être réduit à une norme médicale ou à une performance attendue. C’est une expérience profondément humaine, au croisement de l’identité, des émotions, des relations sociales et d’une phase développementale majeure, la matrescence, qui se répercute sur tous les autres rôles des parents. L’allaitement est aussi soumis à des normes contradictoires : l’allaitement exclusif est fortement encouragé, mais les parents qui allaitent en public ou qui allaitent trop longtemps ou de manière différentes de la norme attendue peuvent être jugés ; l’instinct maternel est valorisé, mais des normes très rigides sur les fréquences, les minutes et la durée de l’allaitement sont imposées. Reconnaître ces ambivalences peut aider les parents à se libérer de la culpabilité et à s’autoriser à écouter leurs propres besoins et ceux de leur enfant afin de choisir un mode d’alimentation plus sereinement, en accord avec leurs valeurs.
Il ne devrait pas s’agir d’une performance, mais bien d’une expérience humaine, unique et signifiante. Chaque expérience d’allaitement mérite d’être soutenue, d’être inclusive et alignée avec ce que chaque famille souhaite, mais aussi d’être ancrée dans le respect des valeurs et des capacités du parent allaitant.
Finalement, au-delà des aspects pratiques et émotionnels, l’accompagnement en allaitement gagne à reconnaître toutes les réalités familiales. Bien que les données probantes soient encore très centrées sur les mères, il est important d’inclure toutes les réalités parentales. L’allaitement peut concerner des personnes trans, non binaires, ou des parents adoptants qui choisissent d’induire une lactation. Chaque parcours est valide et mérite d’être accompagné avec respect, sans exclusion.
